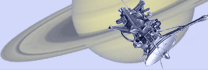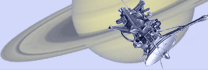La Voie Lactée
Un peu d'histoire
Les hommes ont de tout temps été fascinés par l'arche
lumineuse qui divise la sphère céleste en deux. Les Égyptiens
y voyaient de la farine jetée dans le ciel par la déesse
Isis. Pour les Incas, il s'agissait de poussière dorée issue
des étoiles. Le terme de Voie Lactée nous vient du monde
antique Greco-Romain. Les anciens pensaient observer le lait sorti du
sein de la déesse Héra (Junon), la "Via Lacta". C'est Galilée
qui en 1610, fit basculer la Voie Lactée du domaine du mythe à
celui de la science. Pointant sa lunette vers le ruban céleste,
il découvrit qu'il était constitué d'étoiles
individuellement trop peu brillantes pour être résolues à
l'oeil nu et dont seul la somme des éclats était jusqu'alors
perceptible. Une des premières évocations connue du concept
de Galaxie provient d'un texte de Christopher Wren et date de 1657. Ce
concept fut popularisé au siècle suivant par Emanuel Kant
(1755). Il fallut cependant encore près de deux siècle de
débats et de recherches pour prouver l'existence des "Univers-îles"
(terme employé au XIXème siècle pour désigner
les galaxies).
Cette quête fut intimement liée à l'étude
de la nature des nébuleuses. En 1771 et 1784, Charles Messier publiait
deux catalogues
regroupant 103 nébuleuses. Poursuivant sur cette voie avec des
télescopes de plus en plus grands, William Herschell puis son fils
John cataloguèrent plusieurs milliers de nébuleuses au tournant
des XVIIème et XVIIIème siècle.
Grâce au pouvoir de résolution accrue de leurs instruments,
ils découvrirent que certaines nébuleuses étaient
constituées d'étoiles. Etait-ce le cas pour toutes ? La
réponse vint de la spectroscopie. Les observations de William Huggins
(1864) mirent en évidence deux types de signature spectrale nébulaire,
l'une fort similaire aux spectres stellaires (de nombreuses raies, principalement
en absorption) et l'autre ne contenant que très peu de raies, toutes
en émission. Seules des nébuleuses gazeuses pouvaient engendrer
un tel spectre. Parallèlement au recensement des nébuleuses,
William Herschell, proposait un modèle héliocentrique de
la Galaxie (que nous savons aujourd'hui erroné), utilisant des
comptages stellaires pour en dresser les contours. Un demi-siècle
plus tard, William Parson, troisième lord Rosse observait (1845)
des structures spiralées dans les nébuleuses Messier
33 et Messier 51
(galaxies du triangle et des chiens de chasse), introduisant dans le vocabulaire
astronomique le terme de nébuleuse spirale et marquant le début
de 70 ans de spéculation.
 |
| La galaxie spirale Messier 83 (photo AAO) |
Deux conceptions de l'Univers divisent la communauté astronomique
du début du XXème siècle. Les uns pensent
que l'ensemble des objets célestes sont regroupés en une
unique structure. Les autres militent pour une Voie Lactée entourée
de nébuleuses spirales extragalactiques, reflets forts éloignés
de notre propre Galaxie. En observant en 1923 une Céphéide
dans la Galaxie d'Andromède et en en déduisant sa distance
(bien au-delà des limites de la Voie Lactée), l'astronome
Edwin Hubble clôt le débat. Les nébuleuses spirales
sont bien les soeurs lointaines de notre Galaxie. Quelques années
plus tard, observant qu'elles s'éloignaient de nous d'autant plus
vite qu'elles étaient situées à grandes distances,
il mettait en évidence l'expansion de l'univers.
Aujourd'hui, le terme de Voie Lactée est employé pour désigner
à la fois le disque Galactique vu par la tranche (la "via Lacta"
des anciens) ainsi que l'ensemble de notre Galaxie.
|